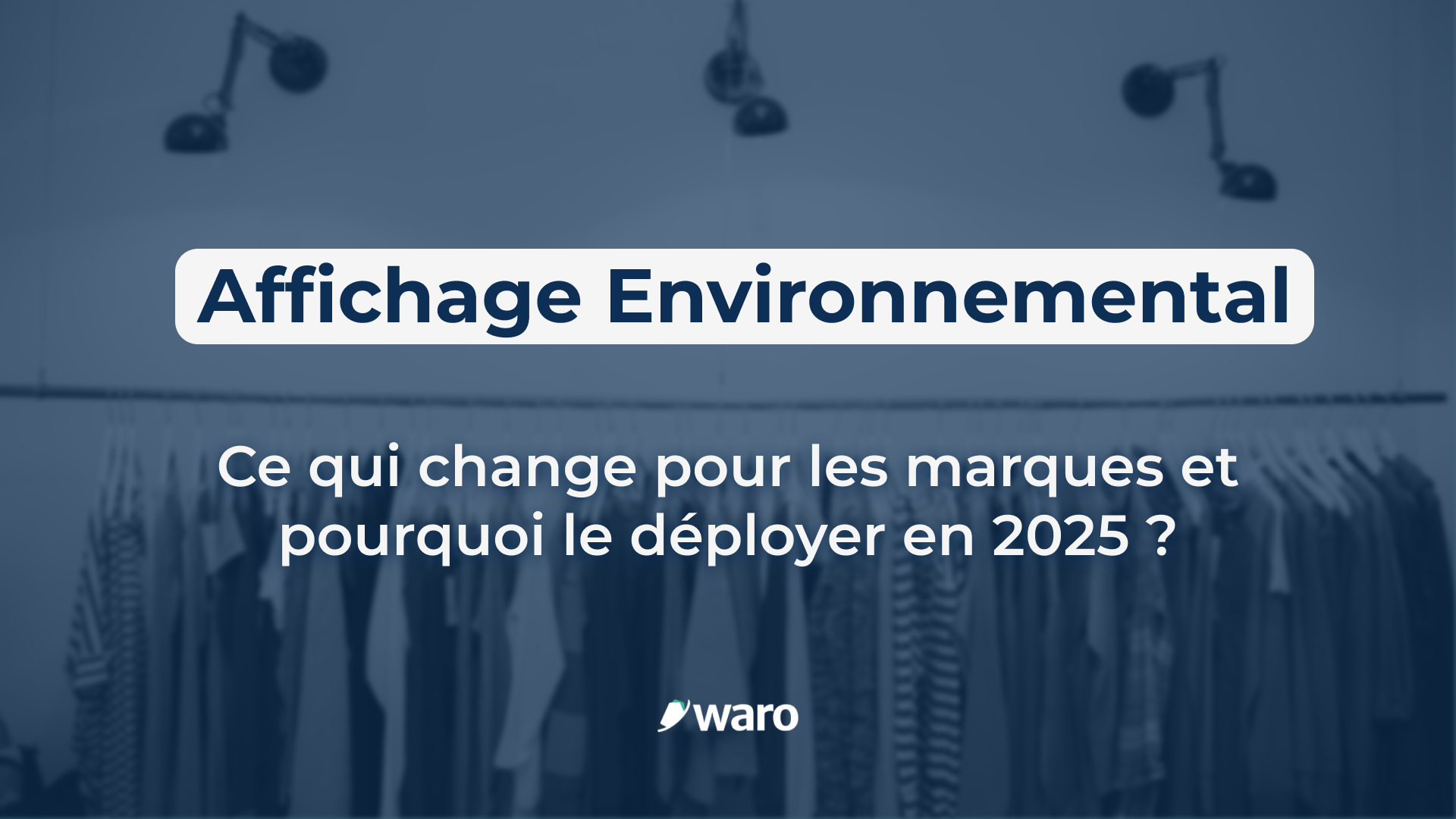
L’affichage environnemental des produits textiles s’apprête à devenir une réalité incontournable du paysage réglementaire français. Validé par la Commission européenne en mai 2025, le décret encadrant le coût environnemental des vêtements pose un cadre robuste pour évaluer et communiquer l’impact environnemental des produits.
Dans cet article, nous revenons sur les grandes étapes à venir, les implications stratégiques pour les marques, et les leviers à activer dès 2025 pour anticiper efficacement ce tournant réglementaire.
Le cadre réglementaire de l’affichage environnemental textile s’inscrit dans une dynamique de fond, amorcée dès 2019 avec la Convention Citoyenne pour le Climat, puis inscrite dans la loi Climat et Résilience de 2021. L’objectif : fournir au consommateur un indicateur fiable, fondé sur l’analyse du cycle de vie (ACV), pour l’aider à faire des choix éclairés.
Après plusieurs années d’expérimentation, le décret sur l’affichage environnemental textile entre dans sa phase opérationnelle.
La capacité des marques à mesurer et maitriser l’impact environnemental de leurs produits devient un enjeu stratégique pour plusieurs raisons :
L’affichage environnemental n’est pas une initiative isolée : il est inscrit dans la loi Climat. Le décret officialise une méthodologie unique, qui devient la référence pour mesurer et communiquer l'impact environnemental des vêtements.
Si une marque souhaite communiquer sur la performance environnementale de ses produits, elle doit désormais utiliser le coût environnemental.
Dans un contexte de greenwashing croissant, seules les allégations environnementales reposant sur des preuves scientifiques validées seront tolérées. Mesurer l’impact réel de ses produits permet de :
À partir de 2026, des tiers (applications, associations, concurrents) pourront publier des scores environnementaux à votre place, sur la base de données publiques ou par défaut.
Ces valeurs par défaut sont généralement pénalisantes : ne pas agir, c’est laisser d’autres définir votre empreinte.
Les attentes consommateurs sont claires :
En communiquant dès 2025, vous bénéficiez :
Le déploiement de l'affichage environnemental s’organise en trois grandes étapes.
La première étape est de collecter les bonnes données pour être en mesure de mesurer l'impact environnemental de vos produits.
Il y a des données obligatoires : le nom du produit, sa catégorie, la date de mise sur le marché, la masse du produit, la composition matière, les étapes de la loi AGEC (assemblage, teinture, tricotage…), et si besoin, les données sur les impressions, les lavages, ou encore le transport.
Puis il y a les données optionnelles, qui permettent de préciser le score : largeur de gamme, prix du produit, présence d’un service de réparation, le taux de transport aérien etc. Plus vous serez en mesure de collecter ces données, plus le score est précis. En leur absence, des valeurs par défaut — souvent pénalisantes — sont appliquées.
Et enfin, il existe des données plus avancées qui permettent d’aller vers plus loin (écoconception) : taux d’invendus, taux de pertes à la confection, mix électrique, type d’ennoblissement, consommation énergétique, données sur l’emballage, etc.
Avant toute communication, les scores doivent être déposés sur un portail officiel (accessible dès la publication du décret).
Ce portail vise à :
Des plateformes partenaires (comme Waro) pourront directement assurer le dépôt des coûts environnementaux de vos produits.
Une fois le score déclaré, vous pouvez le communiquer. Il n’y a pas d’obligation de le faire, sauf si vous communiquez déjà un autre indicateur environnemental (par exemple : le nombre de kilos de CO2, ou un score issu d’une autre méthodologie). Dans ce cas, vous êtes dans l’obligation d’afficher aussi le coût environnemental, avec la même visibilité.
Une fois le score déposé sur le portail de déclaration, vous pouvez le communiquer :

